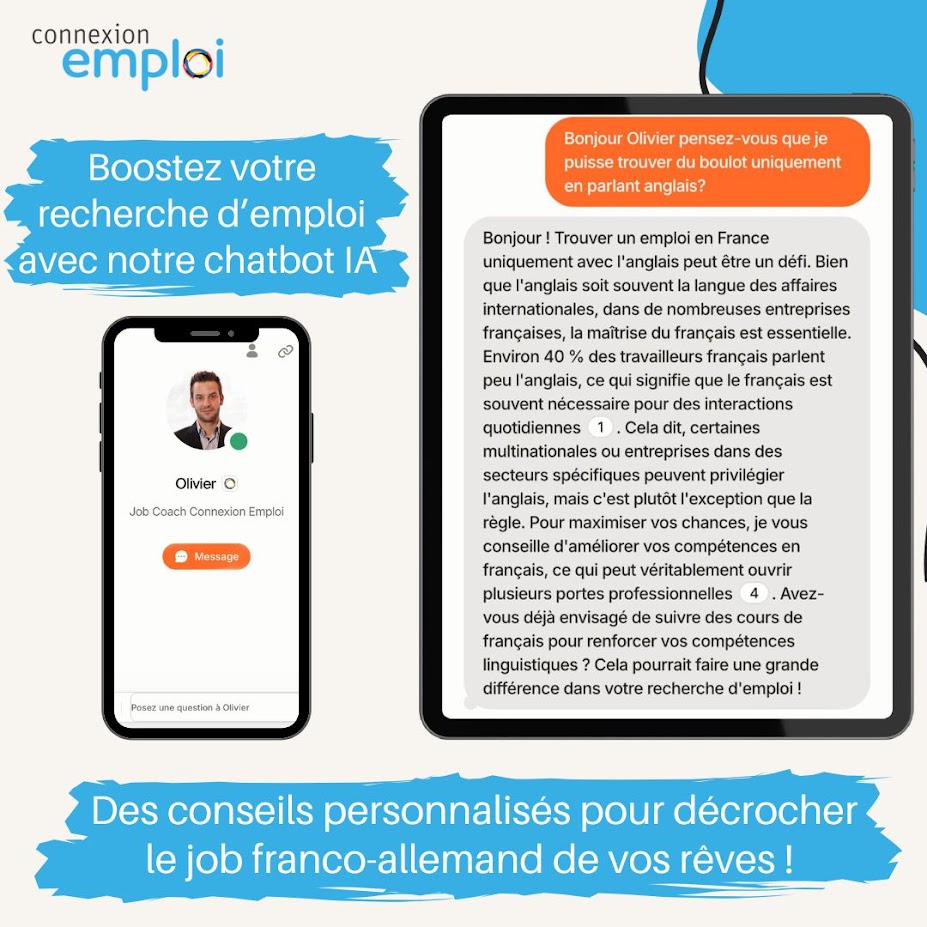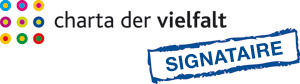Vivre sa maternité en Allemagne : l’expérience de Lise

Devenir mère est une étape marquante dans une vie, et lorsque cela se passe à l’étranger, l’expérience peut être encore plus intense. Lise, une Française de 32 ans, s’est installée à Berlin il y a cinq ans pour y poursuivre sa carrière dans le marketing digital. Lorsqu’elle apprend qu’elle est enceinte, elle se pose de nombreuses questions : Quelles sont les démarches à suivre ? Comment fonctionne le congé maternité en Allemagne ? Peut-elle concilier travail et maternité ? À travers son histoire, découvrons les réalités de la maternité en Allemagne, entre avantages, défis et adaptation culturelle.
2. Un suivi médical structuré et rassurant
3. Le congé maternité en Allemagne : un modèle avantageux
4. Retour au travail : concilier carrière et maternité

Lorsqu’elle fait son test de grossesse un matin de septembre, Lise est partagée entre la joie et l’inquiétude. Sa famille est en France, son compagnon est allemand, et elle se demande immédiatement comment la maternité se passe outre-Rhin. « Je connaissais quelques bases sur le système de santé allemand, mais je ne savais pas du tout comment cela fonctionnait pour une femme enceinte », raconte-t-elle.
Elle prend rapidement rendez-vous chez son gynécologue. En Allemagne, il est courant d’être suivie soit par un gynécologue, soit par une sage-femme en cabinet de Hebamme (sage-femme). Dès la première consultation, on lui remet son Mutterpass, un carnet détaillant tout son suivi de grossesse, un élément clé du système allemand.
Mais ce qui la surprend le plus, c’est l’approche allemande du travail pendant la grossesse. Contrairement à la France, où certaines femmes bénéficient d’un arrêt anticipé, en Allemagne, tant que la grossesse se déroule bien, les femmes travaillent jusqu’à six semaines avant l’accouchement. Une nouvelle réalité pour Lise, qui se demande comment elle va gérer son emploi du temps.

En Allemagne, le suivi de grossesse est réputé pour être très structuré et médicalisé. Lise bénéficie d’une échographie tous les trois mois, ce qui la rassure beaucoup. En plus des consultations avec son gynécologue, elle décide aussi de faire appel à une sage-femme, ce qui est une pratique courante en Allemagne. « Ici, les sages-femmes jouent un rôle essentiel, avant et après l’accouchement », explique-t-elle.
Autre particularité du système allemand : le choix du lieu d’accouchement. Lise découvre qu’elle peut accoucher dans un hôpital, une maison de naissance ou même à domicile si sa grossesse le permet. Après plusieurs visites, elle opte pour un hôpital où l’approche est assez naturelle, avec des salles équipées de baignoires et des sages-femmes très présentes.
Son employeur, lui, se montre très compréhensif. En Allemagne, les femmes enceintes bénéficient d’une protection juridique renforcée, appelée Mutterschutz. Dès l’annonce de sa grossesse, Lise ne peut plus être licenciée jusqu'à plusieurs mois après son retour de congé maternité. Une sécurité qui lui permet d’aborder cette période plus sereinement.

À l’approche de son accouchement, Lise se renseigne sur son congé maternité. En Allemagne, le système est bien différent de la France. Les femmes enceintes ont droit à six semaines de congé avant l’accouchement et huit semaines après (douze en cas de naissance multiple ou de complication). Ce congé, appelé Mutterschutz, est entièrement rémunéré.
Mais ce qui séduit le plus Lise, c’est l’Elterngeld (allocation parentale). Ce dispositif permet de prendre jusqu'à trois ans de congé parental, avec une compensation financière durant les premiers mois. Lise et son compagnon décident de partager ce congé : elle prendra neuf mois, puis il prendra trois mois, une solution courante en Allemagne.
Ce système lui semble bien plus flexible qu’en France, où les congés parentaux sont souvent moins avantageux financièrement. Elle apprécie aussi la culture du temps partiel après la maternité, largement répandue en Allemagne, permettant un retour au travail en douceur.

Après plusieurs mois à se consacrer à son bébé, Lise décide de reprendre son travail. Son entreprise lui propose un temps partiel, une option qu’elle accepte pour mieux gérer sa nouvelle vie de maman. En Allemagne, le droit au temps partiel après un congé parental est protégé par la loi, une avancée qui permet à de nombreuses femmes de ne pas être forcées à choisir entre carrière et famille.
Côté crèche, la situation est plus complexe. Les places en Kita (crèche) sont très demandées, et Lise a dû faire ses démarches très tôt. Heureusement, elle trouve une place dans une crèche bilingue, ce qui lui permet de transmettre ses deux cultures à son enfant.
Aujourd’hui, Lise se dit ravie d’avoir vécu sa maternité en Allemagne. Le système, bien que parfois administratif, lui a offert une grande sécurité financière et professionnelle. Elle apprécie aussi la mentalité plus égalitaire sur le partage des tâches parentales. Si elle devait donner un conseil à d’autres Françaises en Allemagne, ce serait de s’informer très tôt sur les démarches et les options possibles.
Grâce à cette expérience, Lise a non seulement découvert un autre modèle de maternité, mais aussi trouvé un nouvel équilibre entre sa vie de mère et sa carrière professionnelle.
En savoir plus:
- Le congé maternité en Allemagne : quel impact sur la carrière ?
- J’ai pris six mois de congé maternité en Allemagne et je l’ai regretté
- Comment valoriser le congé parental dans un CV en Allemagne


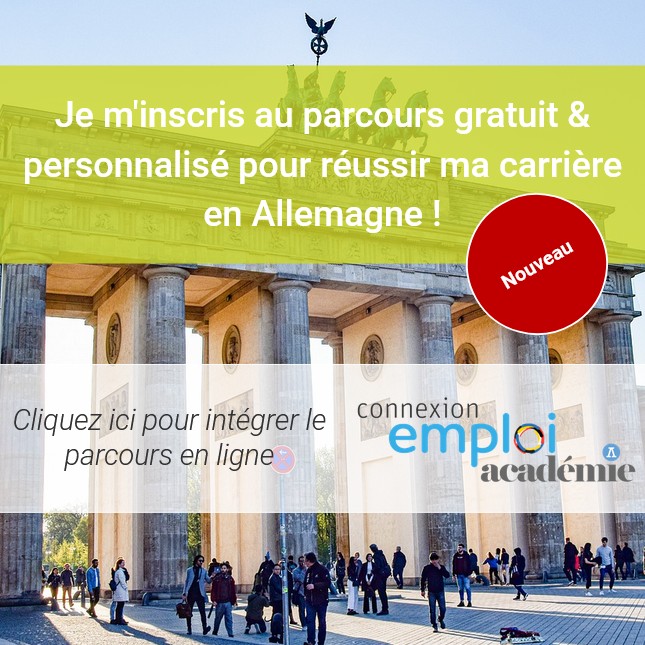

 Fr
Fr De
De En
En